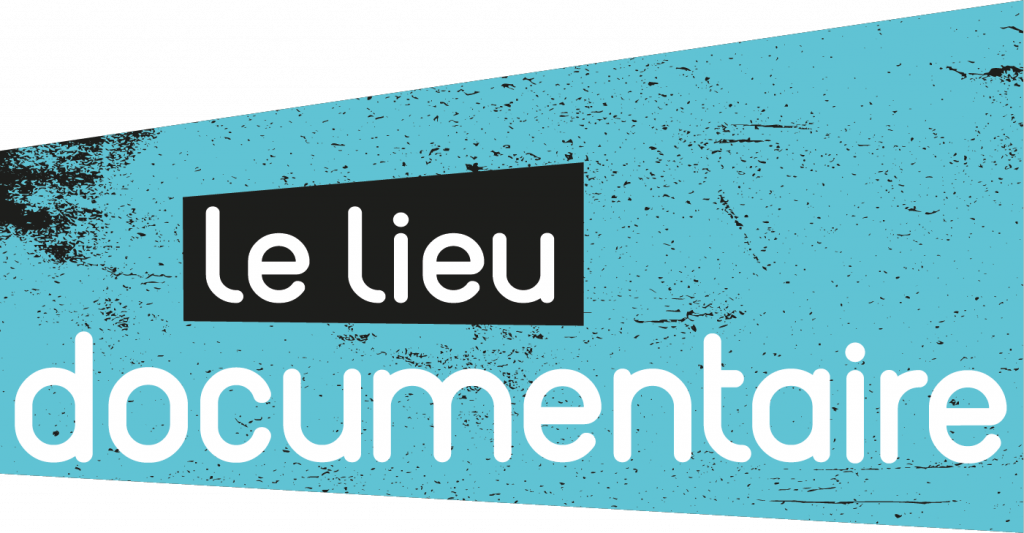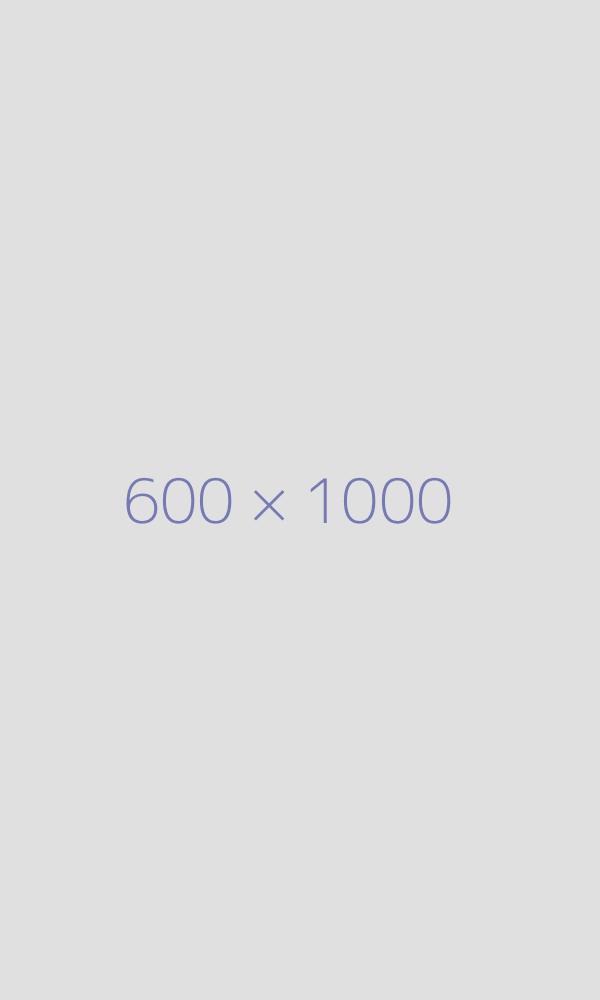Sur une idée de William Klein, la collection Contacts consacre chacun de ses numéros à un photographe contemporain. Lui seul a la parole, en off, commentant chronologiquement un travail de plusieurs années, tandis que défilent à l’écran tirages photographiques, polaroïds ou planches contacts.
Andréas Gursky (1999)
A Düsseldorf où il fait ses études dans les années 1970, Andreas Gursky (né en 1955), fils et petit-fils de photographe, cherche à donner à la photographie en tant qu’interprétation du réel une place qu’elle n’a pas dans l’art contemporain, en Allemagne du moins : architectures urbaines caractéristiques de cette période, puis vastes paysages où se perdent des personnages microscopiques.
Depuis 1989, il choisit des sujets adaptés à de très grands formats : des intérieurs d’usines modernes – il en choisit cinq sur une centaine visitées, les plus “universellement” lisibles -, une barre d’immeubles où l’on y voit “l’encyclopédie de la vie”, ou encore des vitrines de chaussures disposées tels des objets dans un musée, pour enfoncer le clou du fétichisme régnant dans notre société, à l’égard des biens de consommation. C’est à l’aéroport de Roissy qu’il réalise ses premières photographies digitalisées, supprimant des détails “gênants” et les remplaçant par d’autres. Pour l’hémicycle du Parlement allemand, pris en contre-plongée de l’extérieur, l’architecture quadrillée de la paroi de verre lui a permis un montage de photographies de jour, avec reflet sur les vitres, et de nuit, où l’intérieur apparaît distinctement. “Mais toutes mes photos ne sont pas retravaillées électroniquement, et on ne pourra pas dire lesquelles le sont, lesquelles ne le sont pas.”
(Marc Guiga)
Lewis Baltz (1998)
“Je ne me suis jamais considéré comme photographe, ni senti lié à sa prétendue histoire. Je fais des photos, car c’est un moyen direct d’enregistrer les choses, une forme de notation visuelle.” Né en 1945 en Californie du Sud, Lewis Baltz a commencé par saisir en noir et blanc, à la façon d’un anthropologue, ce qu’il voyait autour de lui : une urbanisation homogénéisée en zones pavillonnaires, ultrarapide, poussant au milieu de nulle part.
“Je ne voulais pas avoir de style. A la recherche des signes les plus typiques, je voulais être le plus objectif possible, en posant cependant la question est-ce un monde où les gens vont vraiment pouvoir vivre ?” Lewis Baltz s’enfonce dans ce qu’il nomme “l’obscène”, en photographiant les terrains vagues, l’abandon, le déchet. A partir de 1989, il trouve une implication sociale à son travail. Influencé par une oeuvre de Bruce Nauman, il réalise Generic Night Pictures, une série de cybachromes géants sur les villes européennes la nuit, qu’il veut aussi séduisante que répulsive. Fasciné par l’émergence des technologies, la machine, “qui n’est pas excitante en soi, mais qui règne sur le monde”, il livre des oeuvres monumentales dans lesquelles le spectateur est immergé : Rondes de nuit, à partir d’images de caméras de surveillance, et The Silent Bodies, sur l’hôpital en tant que site technologique. “Ne rien révéler. La vérité, si vérité il y a, est toujours innaccessible.”
(Marc Guiga)
Nan Goldin (1999)
“On a toujours pensé à tort que mon travail portait sur le monde des fêtes, de l”underground’, de la drogue. S’il est vrai que ma famille a toujours été marginale et que nous refusons les normes de la société, je ne crois pas que mon travail parle de ça. Mes photos parlent de la condition humaine, de la douleur et de la difficulté de survivre.”
Boston, début des années 1970 : l’adolescente Nan Goldin vit la nuit dans les clubs ; la beauté des travestis la trouble par-dessus tout ; son appareil photo est déjà pour elle le meilleur moyen de garder les traces de “la vraie vie” et lui fait office de mémoire. Quelques années de dépendance à la cocaïne plus tard, une cure de désintoxication en 1988, elle s’installe à nouveau à New York, rentre dans le champ de ses photographies, découvre l’influence de la lumière naturelle sur la couleur. “Pendant des années, mon travail a traité de la dépendance sexuelle. Je ne suis pas obsédée par le sexe, mais par l’idée qu’on peut être dépendant sexuellement de quelqu’un, qui ne convient pas forcément sur le plan affectif ou intellectuel. Pourquoi ce besoin d’être deux est-il si fort ? J’aime photographier les gens, leur identité sexuelle, leur comportement physique. Je pense qu’il existe bien plus que deux sexes. Tout consiste à avoir le courage de transformer sa propre image.”
(Marc Guiga)
Sophie Calle (1997)
Sophie Calle nous invite à découvrir une histoire où l’art et la vie se confondent : son histoire. De filature en filature, attentive aux secrets des autres, elle exerce des talents de détective photographe, parfois prise à son propre piège. Puis, elle met en scène ses souvenirs dans des récits autobiographiques.
“Ca a commencé par hasard”, confie-t-elle. Sophie Calle (née en 1953) a d’abord photographié des gens au hasard de leurs trajets dans la ville, afin de capter des désirs et de l’énergie qui lui faisaient défaut. Elle accompagne parfois les photographies d’un texte écrit à la manière d’un constat policier, dans un style concis et objectif. De Paris à Venise, la filature d’un homme lui révèle les limites de son jeu : la fabrication d’une obsession. Elle renverse la situation en engageant un détective privé pour la prendre elle-même en filature. Le rapport consigné et le journal qu’elle tient pendant cette période constituent le portrait dédoublé de l’artiste piégée. Rompue au jeu d’épier l’autre, elle dresse maintenant l’inventaire de ses propres histoires.
(Annick Spay)